1. Justifications de la colonisation européenne en Amérique
 |
|
«Pere Marquette and the Indians». Peinture de Wilhelm Lamprecht datant de 1889 inspirée de la peinture murale de l’église St. Mary de Montréal. À noter que cette composition de Lamprecht a été sélectionnée pour l’élaboration du timbre-poste commémoratif distribué en 1898. Document d’archives du The Detroit News. Image puisée à même l’article de Vivian M. Baulch intitulé «The mystery of Pere Marquette's final resting place». Illustration prise sur le site du The Detroit News Rearview Mirror, à la page suivante : http://info.detnews.com/history/story/index.cfm?id=158&category=people. |
Formulés sous forme de témoignages, les récits jésuites, dans lequel la Narration
[39]
du Père Marquette s’inscrit, s’imposent comme des outils de référence majeure pour quiconque s’intéresse à l’entreprise missionnaire des Jésuites en Nouvelle-France. Contestée ou admirée, cette vaste entreprise d’évangélisation des populations amérindiennes du Nouveau Monde implique une certaine relation de dominés/dominants. Or, ce type de relation laisse libre court à de nombreuses interprétations et perceptions qu’il nous importe de nuancer pour bien comprendre la dynamique dans laquelle Jacques Marquette se retrouve lors de son passage dans la région des Grands Lacs. En effet, Marquette arrive en plein dans une vague de colonisation du vaste continent américain. Le moment et le lieu ne sont pas choisis au hasard, de même que sa mission évangélisatrice. Cette section vise donc à tracer le portrait des relations entre Européens et Amérindiens lorsque la colonisation et l’évangélisation européennes en sont encore à leurs premières années et doivent s’organiser.
 |
|
«Jean-Baptiste Colbert, Marquis de |
Force est d’admettre que les relations entre les premiers colons européens et les Amérindiens sont établies selon les perceptions de l’époque. Étant donné que ce sont les Européens qui prennent l’initiative de remodeler le paysage du Nouveau Monde, il est pertinent de se pencher sur leurs premières impressions face à la civilisation amérindienne lors des rencontres initiales en Amérique. Notre réflexion a pour point de départ les propos d’un juriste suisse ayant bénéficié d’une grande autorité en matière de droit international au 18e siècle, Emmerich de Vattel. Représentatif de la pensée courante du moment, ce dernier justifie l’entreprise coloniale en ces termes : «les peuples de l’Europe, trop resserrés chez eux, trouvant un terrain dont les sauvages n’avaient nul besoin particulier et ne faisaient aucun usage actuel et soutenu, ont pu légitimement l’occuper et y établir des colonies […]
[40]
» Cet eurocentrisme évident est fort répandu dans les mentalités de l’époque et il en était certainement de même au 17e siècle, soit au moment où la colonisation de l’Amérique prend son envol.
Quand deux mondes se rencontrent
Or, comment l’Européen se représente-t-il l’Amérindien? Quel genre de personne s’attend-t-il de rencontrer lorsqu’il décide de venir s’installer de l’autre côté de l’océan Atlantique ? La réponse est fort simple : un être inférieur en tous points! Ainsi, dès le départ, il n’hésite pas à le considérer comme «sauvage». Cet argument central que les nouveaux arrivants prennent pour acquis tient du fait que les Amérindiens sont rapidement associés aux sociétés dites primitives. Par conséquent, ils semblent avoir, aux yeux des Européens, «ni foi, ni loi, ni roi». Ainsi, il est clair que l’Européen perçoit ces «sauvages» selon les critères propres à la mentalité occidentale de l’époque, à savoir selon l’importance accordée à la hiérarchie sociale. Et, dans cette perspective, l’Amérindien occupe sans contredit l’échelon le plus bas
[41]
.
Cette position peu enviable lui confère le statut de «pauvre sauvage». Et cette pauvreté se manifeste, selon les Européens, tant sur le plan économique que culturel. En effet, les divers critères qui permettent aux premiers arrivants de juger de la pauvreté du sauvage se rapportent, entre autres, à la nudité des Indiens, au fait qu’ils ne possèdent pas de logement fixe, qu’ils ne connaissent pas Dieu, qu’il ne savent pas écrire, qu’ils ne connaissent pas le fer, qu’ils ont des moeurs sexuelles jugées non conformes, ou encore qu’ils mangent de la viande crue. Pour les nouveaux venus, tous ces éléments font, sans l’ombre d’un doute, du «sauvage» un être primitif. Il n’en faut d’ailleurs pas plus pour prendre pour acquis que l’Amérindien a certainement besoin de la supériorité culturelle et technique de l’Européen. Ce dernier peut ainsi justifier moralement sa présence avec de «nobles motifs».
 |
|
Représentation de Makataimeshekiakiak, surnommé Black Hawk, le chef de la tribu des Sacs reconnu pour sa participation à la guerre de 1812 aux côtés des Britanniques. Image prise sur le site de Wikipedia, The Free Encyclopedia, à la page suivante : http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Black_Hawk.jpg. |
Parallèlement s’ajoute la conviction, pour l’Européen, d’avoir enfin trouvé le paradis terrestre, un concept bien connu de l’imaginaire collectif européen de l’époque. À l’évidence, la nature idyllique de cette terre d’Amérique se confirme par sa salubrité, sa fécondité et sa beauté, de même que par l’abondance qu’elle laisse miroiter ainsi que l’innocence apparente de ses hommes dits «naturels»
[42]
. Dans cette optique, il n’est pas étonnant de constater que le nouvel arrivant en conclut que «les Amérindiens [sont] des enfants de la nature au premier stade de l’évolution humaine»
[43]
. Il lui est alors plus aisé de se considérer supérieur car plus évolué. Ainsi, il s’imagine que sa présence ne peut qu’être bénéfique pour ces pauvres Amérindiens étant au stade primaire de l’évolution. En s’appuyant sur cette vision du paradis terrestre enfin retrouvé, l’Européen prouve son génie car il a découvert bien plus que des nouvelles terres. Il expose ni plus ni moins au monde un mythe qui devient réalité. Enfin, il tente à tout le moins de rendre réel ce concept imaginaire du paradis terrestre. Il s’agit encore là d’un moyen fort efficace de justifier la colonisation puisqu’une lourde responsabilité incombe alors à l’Européen, soit celle de civiliser de pauvres âmes innocentes se trouvant sur ces terres.
Vient se greffer à cette conception, la croyance populaire stipulant qu’il existe des descendants d’Adam ayant une forme monstrueuse vivant dans des contrées inconnues. Le Nouveau-Monde, avec ses «sauvages», ne permet-il pas de rendre réel un autre mythe ? Ainsi, ce monde damné et si effrayant aux yeux des Européens se trouve ailleurs que sur leur propre continent, il n’est plus situé dans leurs forêts. Le mal est en Amérique, ce qui est rassurant pour les populations européennes. Les religieux, principalement les Jésuites, vont saisir cette occasion pour partir en mission afin de rehausser leur prestige et leur notoriété. Pour cette catégorie précise de nouveaux venus, la justification de la présence européenne (principalement en Nouvelle-France) tient du fait que le colonisateur est investi d’une mission : il a le devoir de servir Dieu et de convertir les païens. De toute évidence, le Père Marquette s’inscrit dans cette lignée des gens investis d’une mission évangélisatrice et salvatrice.
 |
|
Illustration [stéréotypée et inexacte] de H. Lawrence Hoffman représentant un chef Mitchegameas. Image prise dans l’ouvrage d’August William Derleth, Father Marquette and the great rivers. New York, Farrar, Straus & Giroux, Coll. Vision Books, 1955 , p. 137. |
Telles sont, globalement, les premières impressions et images véhiculées par les Européens. Ce qui en ressort est essentiellement la dichotomie race inférieure/race supérieure. À ce jeu, l’Européen «supérieur» a le beau rôle puisqu’il a de raisonnables motifs de traverser l’Atlantique; il vient en aide aux «pauvres sauvages». Or, qu’en pensent les Amérindiens qui doivent désormais composer avec de nouveaux venus? Quelles sont leurs premières impressions face aux Européens? À en juger par un témoignage recueilli par le père Le Clercq, ils sont loin de se considérer inférieurs. Face à la supposée supériorité de la nation française, un chef amérindien lui rétorque: «Pourquoi risquer ta vie et tes biens tous les ans et te hasarder témérairement en quelque saison que ce soit aux orages et aux tempêtes de la mer, pour venir dans un pays étranger et barbare que tu estimes le plus pauvre et le plus malheureux au monde
[44]
?» Cet extrait sous-entend une toute autre réalité, à savoir que la présence européenne en Amérique tient plutôt des richesses qui s’y trouvent. Nous sommes donc loin des nobles motifs et des bonnes intentions.
Loin d’ignorer la mécanique de l’entreprise coloniale, les Amérindiens s’estiment pourtant plus heureux que les Français. L’argument central repose sur la liberté dont ils jouissent. En effet, l’Amérindien se sent «partout chez lui» et, contrairement à l’Européen, il ne subit pas l’inégalité d’un système hiérarchisé puisque l’égalitarisme prévaut dans les sociétés amérindiennes du nord-est de l’Amérique. Cette façon de percevoir les choses ne relève pas de l’utopie étant donné que l’Indien jouit d’une plus grande liberté que le Français, ce dernier étant constamment «asservi à un maître, un supérieur, que ce soit un chef de famille autoritaire, un curé, un seigneur, un officier, un magistrat, un gouverneur, un roi
[45]
.»
Force est d’admettre que l’Amérindien, dès les premières rencontres, est fortement jugé, étiqueté et méprisé. C’est que le nouvel arrivant ne cherche pas nécessairement à comprendre celui qui se trouve sur le continent, il cherche plutôt à trouver une façon de s’implanter en Amérique. Pour ce faire, il justifie sa propre présence en se comparant à l’Autre, et ce, à partir de principes occidentaux qui font de lui un être supérieur face au «pauvre sauvage». Pour sûr, cette rencontre de deux mondes aux visions opposées nous est présentée différemment selon la perception amérindienne ou européenne de l’événement. Rapidement, l’Européen se positionne et justifie sa présence à partir de divers mythes, et principalement à travers celui de la supériorité de sa nation. L’Autre est inférieur, pauvre et sauvage. Forcément, l’Européen en conclut que le «pauvre sauvage» a besoin de lui. Cette vision de l’Autre n’est pas des plus réalistes. Les arguments amérindiens servant à justifier la présence française en Nouvelle-France, à savoir le désir de s’enrichir ainsi que la recherche du pouvoir, sont davantage crédibles. Par conséquent, nous sommes en mesure de remettre en question le concept européen de l’Autre et même de renverser la vapeur. En effet, n’est-il pas plus juste d’admettre que l’Autre n’est pas l’Amérindien installé sur le continent depuis fort longtemps, mais plutôt l’«envahisseur» européen ? En changeant ainsi la donne, il ne nous apparaît plus étonnant que ce soit l’Européen qui justifie sa présence, alors que l’Amérindien tente plutôt de l’expliquer.
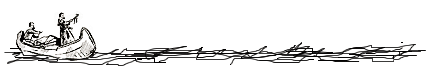
[39] La Narration se définit ici comme étant le récit du premier voyage d’exploration du Père Jacques Marquette dans la région du fleuve Mississippi. Comme mentionné précédemment, il correspond au premier chapitre du Récit des voyages. L’utilisation du terme Narration permet ainsi de distinguer ces écrits de la main de Marquette du reste du manuscrit, de même que de l’ensemble des Relations des Jésuites dans lequel cette source se retrouve.
[40] Emmerich de Vattel, The Law of Nations or the Principles of Natural Law, cité dans Cornelius J. Jaenen, «L’Autre en Nouvelle-France / The Other In Early Canada», loc. cit., p. 4.
[41] François-Marc Gagnon, «Une image toute faite de l’Indien», loc. cit., p. 28.
[42] Cornelius J Jaenen, «Pelleteries et Peaux-Rouges : perceptions françaises de la Nouvelle-France et de ses peuples indigènes aux XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles», loc. cit., p. 110.
[43] Ibid, p. 111.
[44] Extrait de la réponse du chef des Gaspésiens au père Le Clercq à propos de certains Français invitant les Micmacs à se construire des maisons et à vivre à la française. Chrestien Le Clercq, «L’Amérindien s’estime plus heureux que le Français». Nouvelle relation de la Gaspésie, qui contient les moeurs & la religion des sauvages gaspésiens Porte-Croix, adorateurs du soleil, & d'autres peuples de l'Amérique septentrionale, dite le Canada : dédiée à Madame la princesse d'Epinoy. Paris, Amable Auroy, 1691, p. 345-347.
[45] Cornelius J. Jaenen, «L’Autre en Nouvelle-France / The Other In Early Canada», loc. cit, p. 6.